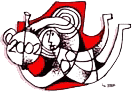
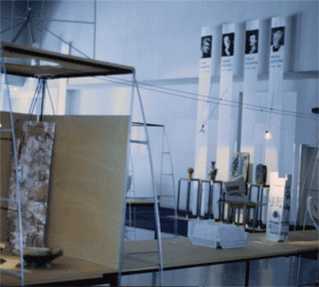
- Présentation de la Biennale
- Télécharger la présentation au format PDF
- Voir les statuts de l'association ABIVAL
- Nous écrire - e mail us
XVIIIe Biennale Internationale
de Céramique d’Art De Vallauris
29 juin - 29 Septembre 2002 Espace loisirs
Vallauris, le 3 avril 2002
Madame, Monsieur,
Vallauris Golfe-Juan, riche de son Patrimoine et de son histoire, a toujours attiré nombre de créateurs et artistes. Cette tradition, plusieurs fois centenaire, se poursuit avec toujours autant d’énergie et cette ville attire toujours autant d’artistes.
L’Histoire de notre ville est parfois mal connue. C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire d’en rappeler les grandes lignes que vous trouverez dans le document joint. Il est de notre devoir d’encourager et d’aider à mettre en place une sauvegarde du Patrimoine plus scientifique et réelle. Ce qui aura pour effet de rendre aux habitants une identité qui est parfois mal connue, et aussi à tous ceux qui désirent s’installer dans cette ville, une idée des lieux qu’ils vont enrichir par leur apport.
L’Histoire de notre ville s’écrit tous les jours, c’est la raison pour laquelle l’écriture artistique évolue tous les jours et nombre d’artistes y participent au quotidien.
Aujourd’hui on trouvera sur le territoire de la commune tant la tradition potière héritée de plusieurs siècles de fabrication de poterie, que des artistes contemporains qui vont travailler des matériaux plus modernes.
Tradition et modernité trouvent réellement à Vallauris leur source d’inspiration. Les échanges et les passerelles existent.
Il est du devoir de notre Municipalité d’aider et de favoriser ces échanges et d’offrir les moyens nécessaires à leurs expressions.
Cette année, à l’occasion de la XVIIIème Biennale, un effort tout particulier a été entrepris afin que celle-ci marque l’entrée de cette tradition dans le XXIème siècle.
Le Maire de VALLAURIS - GOLFE-JUAN
Présentation de
la XVIII ème Biennale Internationale de Céramique d’Art de Vallauris 29 juin / 29 septembre 2002
En Effet, c’est en 1966 que les Céramistes résidents dans la commune décident de faire de Vallauris, déjà illustre par l’oeuvre de Pablo Picasso, le centre Mondial de la Céramique.
Ils proposent donc la création d’un concours national rassemblant les meilleurs artistes et artisans travaillant en France ( potiers, designers, plasticiens ou céramistes d’architecture ).
Cette idée séduit très vite de hautes personnalités de l’Art Contemporain dont André Malraux et Pablo Picasso, ainsi que de très nombreux autres créateurs, si bien qu’en 1968, sous la direction d’Alexandre Kostanda et de Marcel Giraud, c’est une Biennale internationale de céramique d’art qui voit le jour.
Comme les précédentes, la XVIIIème Biennale est dotée d’un concours qui permet de découvrir et, de voir se confronter les oeuvres des plus grands créateurs contemporains des cinq continents. Par ailleurs un effort tout particulier a été fait pour les jeunes créateurs.
L’objectif qui a été fixé pour 2002 est de mettre en place une organisation pérenne qui permette à cette manifestation traditionnelle de s’ancrer à l’avenir dans la vie de Vallauris-Golfe-Juan.
C’est pourquoi l’organisation de cette Biennale s’inscrit dans une démarche participative avec le soutien de :
- un comité local d’organisation avec un commissaire général
- une association pour la promotion des Biennales ( ABIVAL )
- un jury de personnalités des arts et de la culture
- un comité d’honneur de la Biennale
-un collectif d’associations de Vallauris-Golfe-Juan.
Le comité d’organisation de la Biennale est composé d’élus, de professionnels reconnus et de bénévoles qui apportent leur compétence et leur dynamisme au projet. L’ensemble des partenaires se réunit régulièrement depuis le mois de juin 2001 pour réaliser le travail de structuration et de logistique de la future Biennale 2002.
S’appuyant sur les Biennales précédentes , le comité a élaboré un projet qui a été présenté aux élus, et à la population, lors de réunions publiques.
Un règlement de participation des artistes a été définit et approuvé par l’ensemble du comité.
Un site internet Biennale ( adresse : www.vallauris-golfe-juan.com ) précise les règlements et conditions d’adhésion en cinq langues. Les documents d’inscription ont été expédiés à l’ensemble des ambassades, des écoles d’art, des céramistes et d’associations de céramistes, et de la presse spécialisée.
Ainsi,
- 2500 dossiers de candidature ont été expédiés directement aux artistes
- 150 dossiers d’information aux ambassades
- 200 dossiers aux écoles d’art
Dés à présent, nous tenons à remercier les attachés culturels des ambassades pour l’important travail de communication qui a permis une très forte participation.
Le jury s’est réuni les 20 et 21 février pour choisir à travers les 821 diapositives les oeuvres qui seront présentées à la XVIIIème Biennale. Le détail vous est donné dans son rapport , joint au dossier. Ce même jury se réunira à nouveau les 10, 11 et 12 mai pour l’attribution des prix :
Grand Prix de la Ville de Vallauris (10 000 e),
Prix du jeune céramiste (3 800 e),
Prix du public,
Vallauris 21 siècles de poterie
Comme d’autres régions méditerranéennes,
la Provence orientale a abrité très tôt des populations
sédentaires. C’est probablement sur ce territoire, en effet, qu’ont
vécu, voici plusieurs centaines de milliers d’années, les premiers
ancêtres des Français.
A une époque plus proche de nous, à proximité de la mer,
dès le néolithique parfois ou à l’âge du bronze,
de nombreuses petites agglomérations étaient juchées
sur des hauteurs qui facilitaient la défense contre d’éventuels
ennemis.
Vallauris fut l’une d’entre elles au début de son histoire.
A la fin du Xème siècle, la terre de Vallauris fut englobée
dans le fief de Rodoard, un des premiers comtes de Provence. Ce Rodoard, devenu
ainsi seigneur d’Antibes et d’une partie de ses confins fut l’ancêtre
de la Maison de Grasse. A sa mort, le territoire vallaurien fut partagé
entre ses trois enfants.
Aux XIème et XIIème siècles, une série de donations
et de transactions fit de l’Abbaye de Lérins le propriétaire
de Vallauris.
Les moines de l’Abbaye furent des constructeurs, et nous leur devons la chapelle
du XIIème siècle, aujourd’hui musée national, abritant
la très fameuse fresque de Picasso : " La Guerre et la Paix ". Ils
bâtirent également, plus tard, les chapelles rurales dont Notre
Dame des Grâces, Saint-Jean et la Miséricorde.
L’histoire de Vallauris, jusqu’au milieu du XVème siècle est
parsemée d’événements tragiques (épidémies,
guerres civiles, pirateries) qui déciment complètement le village.
Vallauris fut repeuplé seulement au début du XVIème siècle,
à l’instigation de Rainier Lascaris, prieur et seigneur temporel du
territoire. Le premier acte d’habitation est celui du 20 avril 1501, dont
Vallauris fêta avec solennité, en 2001 le cinq centième
anniversaire.
Le second acte, daté du 2 octobre 1506, facilita l’arrivée d’immigrants
de la côte ligure. Ils construisirent l’actuel vieux village selon les
plans fournis par l’évêque de Grasse, commendataire de Lérins
: Augustin Grimaldi. L’arrivée de ces immigrants donna une nouvelle
impulsion à la vieille céramique locale, qui, alors, produisait
surtout des briques et des tuiles. Parmi les nouveaux venus figuraient, en
effet, des hommes originaires des villages du Ponant, tel Albissola et de
Viareggio, où la poterie constituait une activité traditionnelle.
La légende veut que ce fût un de ces hommes employé à
creuser un puits à proximité du village qui découvrit
une grosse quantité d’argile. Il soumit cette terre à l’appréciation
d’un de ses collègues qui avait travaillé comme ouvrier dans
l’une des fabriques de poteries d’Albissola, ce dernier envoya un sac de terre
à son ancien patron en lui demandant de la travailler pour en connaître
ses qualités. Un mois se passa et son ancien patron lui répondit
que cette argile était réfractaire, facile à l’emploi
et que les aliments cuisinés dans les pots fabriqués avec cette
terre avaient meilleur goût. La nouvelle se répandit et peu de
temps après des ouvriers potiers vinrent s’assurer que ce filon pouvait
donner lieu à l’installation d’une fabrique de poterie. Le filon semblait
important et pouvait alimenter plusieurs fabriques… !
L’artisanat se développa rapidement, mais jusqu’au milieu du XVIIIème
siècle, l’essentiel de la production céramique était
constitué par la poterie culinaire, dont les pignates (marmites) formaient
l’article courant. On comptait en 1775, cent cinquante personnes environ qui
travaillaient dans les vingt et une fabriques de poteries.
La matière première était fournie par l’argile rougeâtre
des terriers locaux et l’argile blanche ou grise qu’on mélangeait parfois
à la première. On cuisait dans des fours à bois. Les
vernis qui recouvraient certaines pièces étaient obtenus par
un mélange d’alquifoux et de sable.
Au XIXème siècle, comme au siècle précédent,
c’est encore la céramique qui occupait la plus grande partie de la
main-d’œuvre non agricole, mais à côté de la production
culinaire traditionnelle des Milazzo, Saltalamachia, Foucard, Rubino, Parisi,
on vit apparaître la poterie artistique.
Les frères Maurel vers 1830 commencèrent à produire de beaux vases décorés à l’italienne. Par la suite les Massier appartenant à une dynastie d’artisans donnent les lettres de noblesse à la production artistique. Ils étaient trois, nés au milieu du XIXème siècle : Delphin l’aîné et Clément le cadet, puis leur cousin germain Jérôme. Tous les trois ont connu la notoriété et même la gloire.
Leur œuvre, considérable, s’est étalé sur un demi-siècle, séduisant les grands de ce monde (Victor Hugo, la reine Victoria, Saint-Saëns, Emile Zola etc.). Toute cette brillante activité dura jusqu’aux premières années du XXème siècle. On doit retenir de cette époque le travail de quelques céramistes de réel talent, comme Jean-Baptiste Gaziello ou Giorgi ou également le celui de l’atelier BACS à Golfe-Juan, où se réunirent les Barol, Alexandre, Carle et Sicard que la guerre de 1914 dispersa.
L’après première
guerre vit le déclin de la céramique d’art à Vallauris.
Dès 1930, et plus encore après la seconde guerre mondiale, la
renaissance inespérée des arts du feu est due à l’heureuse
influence de quelques artistes, hommes et femmes, étrangers au pays,
qui se mêlèrent aux bons artisans locaux et ont conféré
peu à peu à la production vallaurienne une renommée internationale.
C’est Jean Gerbino (1930), inventeur de la mosaïque qui porte son nom,
ou Suzanne Douly (1938), qui installe avec son mari Georges Ramié l’atelier
Madoura, ou encore André Baud (1942) débarquant de Fernay-Voltaire.
C’est en 1946 qu’un prestigieux personnage visita dans notre Cité son
excellent ami :
le peintre sculpteur Giovanni Léonardi.
Il revint un an plus tard et, grâce au dynamisme de Suzanne Ramié
qui l’installa dans ses ateliers et l’initia aux techniques de la poterie,
ce personnage en quête d’histoire scella durant vingt-cinq ans son destin
à celui de Vallauris.
La grande épopée de la céramique d’art pouvait commencer.
Pablo Ruiz Picasso était devenu potier.
Dès lors Vallauris sera le lieu de rencontre de l’aristocratie artistique
avec des séjours plus ou moins marqués de célébrités
comme Matisse, Chagall, Miro, Dufy, Léger, Braque, Foujita, Lurçat
ou encore Jean Cocteau, Jean Marais, Brauner, Pignon, Masson, qui tous à
l’image du Maître vont s’essayer à la céramique.
Ce foisonnement intellectuel attire de jeunes gens avides d’aventures, ils
se nomment : Robert Pérot dont " Le vieux Moulin " restera attaché
à son nom, Roger Capron et Robert Picault (1946), Jean Derval (1947),
Anton Prinner, Marcel Giraud, Les Argonautes, Odette Gourju et son mari Naumowitch,
Irène Kostanda et son fils Alexandre, Dominique Baudart ou encore Gilbert
Portanier, Francine Delpierre, Albert Diatto, Roger Collet, Jacques Innocenti,
Jean-Claude Malarmey, Michel Anasse, Marius Bessone, Gilbert Valentin, Piot
et Albert Thiry, Valdémar Volkoff, et tant d’autres encore.
Les expositions de leurs créations se succèdent, intéressant
un public de plus en plus nombreux et averti des Arts du feu. Dès lors
naîtra l’idée, dans l’esprit des pouvoirs publics et des organisateurs
d’un concours qui aura lieu en 1966 regroupant les meilleurs artistes français,
où les œuvres des Mohy, Raty, Deblander côtoyaient celles des
Maurel et Digan.
Le succès rencontré par cette manifestation engagea les Organisateurs
à internationaliser cette rencontre, qui deviendra dès 1968
la Biennale Internationale de Céramique d’art de Vallauris, à
laquelle une vingtaine de pays participèrent.
La qualité des œuvres retenues, la rigueur de l’organisation et l’indépendance
des jurys suffirent pour faire de cette manifestation le passage obligé
de ceux qui deviendront par la suite les grands noms de la céramique
internationale.
Durant les années qui suivirent, le nombre de participants ne cessa
d’augmenter, pour toucher, dès les années 80, plus de 30 nations
et non moins de deux cents exposants. Près de vingt mille personnes
visitent chaque biennale, des milliers d’œuvres ont été visionnées,
des centaines primées et des dizaines d’artistes consacrés.
La place tenue par la production locale dans cette manifestation a été
plus qu’honorable. Le grand Prix de la Ville de Vallauris consacra trois de
nos céramistes. Ce fut Roger Capron en 1970, Gilbert Portanier en 1982
et Marius Musarra en 1988.
Incontestablement Vallauris a durant plus de 30 ans permis à un public
de plus en plus large de découvrir l’Art céramique et récompenser
de jeunes talents qui sont aujourd’hui au sommet de leur art.